Le climat
[download_after_email id= »452″]
Ebook gratuit : Le climat – Sciences, diplomatie et solidarité, de Bernard Tardieu, Editeur : EDP Sciences 2017
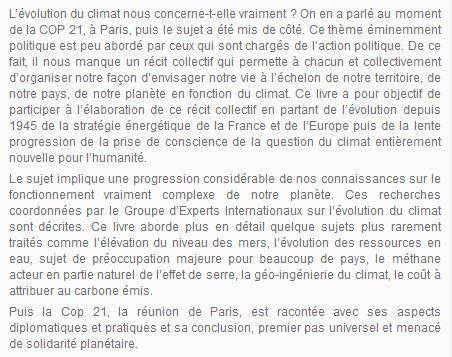
[download_after_email id= »452″]
Ebook gratuit : Le climat – Sciences, diplomatie et solidarité, de Bernard Tardieu, Editeur : EDP Sciences 2017
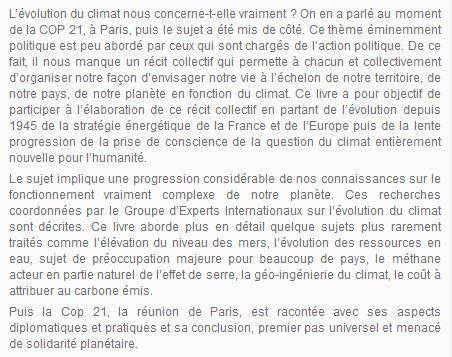
Le programme européen Interreg SUDOE vient d’accepter le lancement du projet EnerbuiLCA (Life Cycle Assesment for Energy Efficiency in Buildings).
Ce projet promet de structurer l’approche par Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans le secteur de la construction de tout le sud-ouest de l’Europe. Mené par un partenariat franco-hispano-portugais (Nobatek pour la représentation française), il débutera dans les semaines à venir et aboutira notamment à la mise en place d’une plateforme pour l’ACV bâtiment à disposition des entreprises du sud-ouest de l’Europe.
[download_after_email id= »455″]
Ebook gratuit : Les villes non occidentales – Comprendre les enjeux de la diversité urbaine, Gabriel Fauveaud (dir.) Presses de l’Université de Montréal, 2017
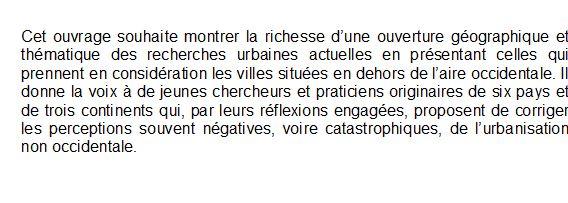
Les écolieux d’initiative strictement citoyenne (ce qui n’empêche nullement qu’ils soient être réalisés en concertation avec les collectivités locales) et souvent militante, fréquemment situés en zones rurales. Comme le signale Passerelle Eco, les écolieux sont extrêmement divers, fruits d’expériences collectives fortement empreintes de la personnalité et des valeurs de leurs initiateurs, il est donc difficile de les enfermer dans une définition catégorique. Cependant certaines caractéristiques semblent se dégager des définitions que l’on trouve ça et là.
La dimension logement n’est qu’une des dimensions du projet et n’est d’ailleurs pas forcément la principale. Ce sont des lieux d’activités agri-rurales : culture (souvent bio), accueil et parfois hébergement du public, sensibilisation et formation à l’écologie, activités artistiques…
L’écologie dans tous ces aspects y tient une place prépondérante et les réalisations sont souvent plus ambitieuses en termes d’éco et d’autoconstruction que celles des écoquartiers.
Les écolieux sont souvent inscrits dans une recherche de la plus grande autonomie énergétique et économique (d’où l’existence d’activités).
La communauté humaine dans sa dimension philosophique et spirituelle y tient une place très importante avec souvent une recherche active autour des notions de développement personnel.
Carapa (Gard, Cévennes)
La Ferme du Collet (Alpes Maritimes)
Oasis Bellecombe (Drôme), affiliée au mouvement Oasis en Tous Lieux de Pierre Rahbi.
En conclusion : la variété des projets est suffisamment grande pour que chacun trouve matière à réaliser ses aspirations et témoigne de la vitalité de ce phénomène qui est assurément amené à évoluer encore.
[download_after_email id= »446″]
Ebook gratuit : Changement climatique – Un défi pour les ingénieurs, editeur : FEDP Sciences – avril 2018
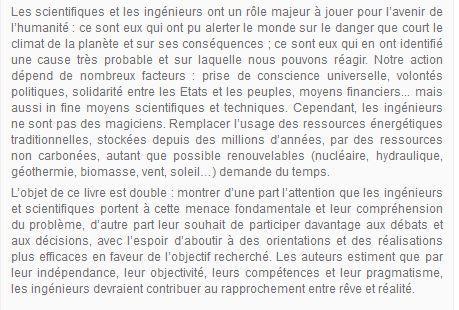

Aujourd’hui, je vous emmène dans les Alpes suisses, dans un chalet de bois centenaire qui a repris vie grâce aux architectes du studio Lacroix Chessex.
Une rénovation et une extension de maison qui marient pour le meilleur l’ancien et le moderne, la couleur et les teintes naturelles.

Oui, il nous fallait faire une extension du chalet en touchant le moins possible à la partie existante nous disent les architectes ; d’autre part, il fallait également créer des ouvertures entre le haut et le bas de la partie existante car on ne pouvait pas passer du sous-sol à la partie habitable sans sortir du chalet. Les sociétaires souhaitaient également que l’extension s’intègre naturellement au bâti existant et intégrer l’escalier en le couvrant. Pour finir sur cette question, il a fallu déplacer la fosse septique enterrée sous l’extension et tous les raccordements existants.
L’orientation de la maison et son emplacement ne permettaient une extension que dans un sens, en amont. Nous en étions conscients, les sociétaires et moi ; lors de la visite avant travaux, on a discuté de leur projet et des possibilités et sa finalisation s’est faite tout naturellement. De toute façon, il n’y avait pas cinquante solutions.
Des travaux d’extensions de maison bois réalisés aussi par des artisans de Montpellier
[download_after_email id= »459″]
Ebook gratuit : La montagne explorée, étudiée et représentée : évolution des pratiques culturelles depuis le xviiie siècle, Louis Bergès (dir.), Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques , 2020
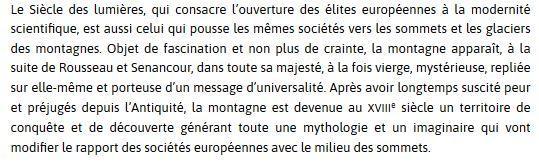
[download_after_email id= »457″]
Ebook gratuit : Transition énergétique – la France en échec, De Gilbert Bruhl -.Dir), EDP Sciences – Collection : Hors Collection – octobre 2018
[download_after_email id= »449″]
Ebook gratuit : Innovation et développement dans les systèmes agricoles et alimentaires, de Guy Faure (dir.), Éditeur : Éditions Quæ 2018
La difficulté de donner une définition précise de ce qu’est un écolieux tient à la grande diversité des écohameaux, villages, quartiers, à leur caractère parfois éphémère (ouverture pour une saison, quelques années…) et au développement récent d’une approche institutionnelle du concept (dans le cadre des agenda 21 et de la politique de développement durable) qui s’éloigne assez notablement de celle des militants qui furent les premiers à l’origine de la création d’écolieux.
Au point que l’on peut ici distinguer deux définitions différentes.
Les écoquartiers (et écohameaux promus par « hameaux durables« ) développés dans le cadre des politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme sont avant tout des habitats groupés mettant en oeuvre des techniques de conception et de construction plus ou moins écologiques pour limiter l’empreinte écologique des réalisations. Ils se situent le plus fréquemment en zone urbaine ou péri-urbaine. L’initiative de ces projets peut être aussi bien le fait de collectivités territoriales que de groupes de futurs habitants (et dans ce cas s’inscrivent souvent dans le cadre d’appels à projet lancés par les collectivités pour la réalisation d’écoquartiers). Ils partagent la plupart des caractéristiques des cohabitats et habitats groupés, le degré de participation effective des futurs habitants à la définition de leur habitat pouvant varier selon le contexte.
Quelques exemples de projets
HNord (Bordeaux)
Eco-hameau de Saint-Herblain (Loire-Atlantique)